Alors que l’Arménie et l’Azerbaïdjan s’approchent d’un accord de paix, de nombreuses interrogations subsistent sur les conséquences réelles de ce traité pour l’avenir du peuple arménien. Bien que la paix soit un objectif légitime et souhaitable, les conditions actuelles de l’accord comportent de graves dangers pour la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Arménie. De plus, la gestion de ces négociations par le gouvernement de Pashinyan soulève des inquiétudes majeures quant aux concessions accordées à Bakou.
Depuis 2021, des troupes azerbaïdjanaises occupent illégalement plusieurs zones en Arménie, notamment dans les régions de Syunik et de Gegharkunik. Cette présence militaire constitue une violation flagrante de l’intégrité territoriale de la République d’Arménie et compromet la stabilité du pays. Avant toute signature d’un accord, le retrait de ces forces doit impérativement figurer comme une condition non négociable. Finaliser un traité de paix sans cette garantie légitimerait une occupation militaire et ouvrirait la voie à de nouvelles revendications territoriales de Bakou, qui affiche ouvertement ses ambitions sur Erevan et Sevan, considérant l’Arménie comme « l’Azerbaïdjan occidental ».
L’Azerbaïdjan exige également que l’Arménie modifie sa Constitution pour supprimer toute référence aux droits des Arméniens d’Artsakh. Une telle modification imposée par un État tiers constituerait un précédent dangereux, montrant que l’Arménie perd le contrôle de ses propres lois. Ce serait une capitulation politique qui affaiblirait la position de l’Arménie dans toute négociation future, la soumettant ainsi aux diktats de Bakou. Pourtant, le gouvernement de Pashinyan semble prêt à accepter cette modification sous prétexte de favoriser un semblant de paix, au mépris des conséquences à long terme.
Un autre point majeur de préoccupation est l’ouverture d’un corridor reliant l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan, et donc à la Turquie, en passant par la région arménienne de Syunik. Ce passage stratégique créerait une route sous influence turco-azerbaïdjanaise, affaiblissant la souveraineté de l’Arménie sur son propre territoire. Outre l’exposition à des risques sécuritaires accrus, ce projet réaliserait le rêve ultime des panturquistes : établir une continuité territoriale pan-turque, un objectif qui remonte à l’époque ottomane. Cette ambition se concrétiserait donc avec la signature de ce traité par deux hommes, dont le Premier ministre arménien.
Par ailleurs, le gouvernement arménien adopte une posture de plus en plus conciliante envers la Turquie, allant jusqu’à minimiser la question du génocide arménien. Cette dérive inquiète profondément, non seulement en Arménie, mais surtout au sein de la diaspora, dernier rempart contre le négationnisme turc. Sous la pression d’Ankara, Pashinyan et son administration cherchent à affaiblir la diaspora traditionnelle, qui incarne encore la mémoire du génocide et la lutte pour sa reconnaissance internationale. Un traité de paix commandité par Ankara effacerait progressivement cette mémoire au sein de l’État arménien, une nouvelle étape funeste pour le pouvoir en place après la capitulation en Artsakh. Ce serait un abandon historique, une soumission idéologique qui trahirait des générations de survivants et de militants ayant consacré leur vie à défendre la vérité et la justice.
L’accord reconnaîtrait officiellement l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, entraînant l’abandon définitif des Arméniens d’Artsakh, déportés après l’offensive militaire azerbaïdjanaise de 2023. Cette décision validerait l’exode forcé de plus de 150 000 personnes, légitimant la disparition de la République d’Artsakh et mettant en péril leur droit de retour sur leurs terres ancestrales.
Ce droit ne pourrait même pas être défendu par le Groupe de Minsk de l’OSCE, puisque l’Azerbaïdjan exige sa dissolution, ainsi que l’interdiction de toute force internationale de maintien de la paix et l’arrêt brutal de la mission d’observation européenne. Or, ces garanties de sécurité sont essentielles pour prévenir de nouvelles agressions. Sans un cadre solide assurant la protection de ses frontières, l’Arménie se retrouverait dans une position de vulnérabilité face à l’Azerbaïdjan, qui ne cache pas ses ambitions expansionnistes et les impose par la force. Mais ses violations passées sont restées impunies, sans qu’aucune sanction répressive ne soit appliquée. Par conséquent, l’enforceabilité même de cet accord est incertaine, car rien ne contraint réellement Bakou à le respecter.
Un autre sujet que le traité ignore est la libération des otages arméniens. Malgré les résolutions internationales et les efforts diplomatiques, plusieurs anciens dirigeants artsakhiotes restent captifs en Azerbaïdjan, qui utilise ces prisonniers comme levier de pression dans les négociations. Signer un traité de paix sans obtenir leur libération immédiate serait une humiliation supplémentaire pour le coté arménien et une trahison envers leurs familles.
Enfin, le traité imposerait à l’Arménie de renoncer à toute action judiciaire contre l’Azerbaïdjan devant les tribunaux internationaux pour les crimes commis durant la guerre des 44 jours. Un tel renoncement légitimerait les crimes de guerre perpétrés contre les Arméniens d’Artsakh et encouragerait de nouvelles violations du droit international.
Dans ces conditions, signer un accord de paix avec l’Azerbaïdjan reviendrait à se plier aux volontés de Bakou, consacrant l’affaiblissement de l’Arménie sur tous les plans : militaire, politique, territorial et historique. La paix doit être recherchée, mais pas au prix d’une soumission totale aux exigences de Bakou et d’Ankara. Avant toute signature, il est impératif d’exiger des garanties fermes sur la sécurité du pays, le respect de sa souveraineté et la préservation de son héritage historique.
Une paix durable ne peut être construite sur des concessions unilatérales. L’Arménie doit refuser de signer ce traité tant que les conditions adéquates ne sont pas remplies.
Harout Chirinian


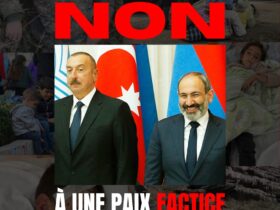



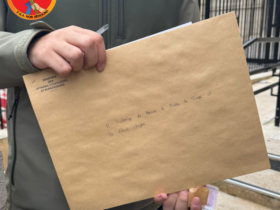

Follow Us