Un article à partager sans modération. Car il n’est de pire insulte à la mémoire des morts, aux souffrances des otages, à la douleur des familles, que d’oser évoquer une paix « en l’état », sans conditions, oublieuse du passé, au nom d’un utopique vivre ensemble des individus.
C’est pourtant ce qui est relayé à l’envie par les médias internationaux qui mettent sur un pied d’égalité agresseur et agressé : il suffirait de déposer les armes, pour que la paix soit.
C’est aussi, honteusement, une pensée montante chez certains Arméniens : en Arménie, en France et certainement ailleurs en diaspora. Il suffirait de développer les relations économiques, et la paix serait.
Si une colère profonde est à l’origine de cet article, ce n’est pas elle qui le dicte. Au contraire, l’objectif est d’expliquer, en quelques points de froide analyse, pourquoi la paix avec l’Azerbaïdjan et son mentor la Turquie est impossible sans conditions.
[1/4] La paix est impossible, car la guerre n’est pas terminée.
C’est un accord de cessez-le-feu qui a été signé le 9 novembre 2020 entre les représentants des États d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan. Ce n’est ni un traité de paix, ni un accord définissant communément la frontière entre les territoires des ex-belligérants. D’ailleurs, si un tel accord était signé, il devrait l’être entre la République autoproclamée d’Artsakh, attaquée, et l’Azerbaïdjan. L’Arménie, République indépendante de ces deux entités, ne devrait pas être concernée.
Une nouvelle guerre se prépare, plus tôt qu’on le croit : le 10 décembre à l’occasion d’une parade militaire célébrant la victoire à Bakou, le Président azéri Aliyev a revendiqué la capitale de l’Arménie, Erevan, comme une terre historique azérie qu’il faut libérer, de même que le Syunik et la région de Sevan. Erdogan, invité d’honneur, a chanté les louanges d’un génocidaire de 1915.
[2/4] La paix est impossible, sans une volonté de vivre ensemble.
L’Organisation des Nations Unies a fait du 16 mai la journée internationale du vivre ensemble en paix. Et voici les définitions qu’elle donne : « Vivre ensemble en paix, c’est accepter les différences, être à l’écoute, faire preuve d’estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d’harmonie. […] La paix n’est pas simplement l’absence de conflits, mais est un processus positif, dynamique, participatif qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération ».
L’Arménie a rendu à l’Azerbaïdjan l’ensemble des prisonniers de guerre qu’elle détenait. L’Azerbaïdjan, toujours pas. Ils sont plusieurs centaines, dont des femmes, à subir encore tortures et privation de liberté. Ce ne sont d’ailleurs pas des prisonniers de guerre mais des otages, la majorité ayant été capturée après la déclaration de cessez-le-feu du 9 novembre.
Les tortures et humiliations subies sont filmées, relayées comme étendards sur les réseaux sociaux. L’arménophobie des Azéris se donne à voir à l’envie, pour peu que l’on refuse de fermer les yeux. Toutes les règles internationales en matière de droit humanitaire sont violées.
[3/4] La paix est impossible, car ce n’est pas une guerre qui oppose l’Azerbaïdjan à l’Arménie. C’est contre la politique génocidaire panturque que se défendent les Arméniens.
La guerre déclarée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh, terre historique arménienne plurimillénaire, n’est pas une guerre nouvelle. Ce n’est tout simplement pas une guerre. C’est la continuation de la politique génocidaire engagée par l’Empire ottoman en 1915, selon laquelle tous les Arméniens d’Anatolie – et de Navarre (cf. actions des Loups gris en France et ailleurs) – doivent disparaître.
Ce qui motive l’Azerbaïdjan, soutenue et dirigée par la Turquie, c’est l’arménophobie. Autrement dit, la haine de l’autre, la haine de l’Arménien. Les petits Azéris apprennent dès l’enfance que les Arméniens sont des monstres, dans le cadre d’une politique éducative organisée par l’État. À son retour à Bakou en 2012, l’officier azéri Safarov qui avait assassiné un Arménien dans son sommeil lors d’un stage organisé par l’Otan en 2004, est accueilli en héros et décoré. Les Azéris ayant eu la « joie » de couper une tête arménienne lors de la dernière guerre ont bénéficié du même traitement. Un bon Arménien est un Arménien mort, tout Azéri ou Turc dont le cerveau a été « lavé » en ce sens, le sait.
Le stade terminal de cette politique génocidaire s’est magistralement donné à voir fin 2020 avec l’utilisation de phosphore blanc (interdit par le droit international) sur les combattants arméniens et les forêts. Passons sur l’écologie. Les brûlures au phosphore blanc rendent leurs victimes stériles. En utilisant cette arme, la coalition panturque s’est assurée que les « heureux » survivants ne pourront avoir de descendance. N’ayant pu arracher leur vie, ils privent leur peuple d’avenir. Ou comment être sûr cette fois, d’éviter « l’erreur » des « restes de l’épée ».
[4/4] La paix est impossible, au nom des droits humains.
Faire la paix avec l’Azerbaïdjan et la Turquie sans condition :
- C’est enterrer l’Histoire, sur laquelle sont bâtis les droits humains, et par conséquent toute velléité de justice et de paix. Traite des humains, xénophobie, nazisme… sans leur condamnation, que seraient aujourd’hui les sociétés occidentales ?
- C’est reconnaître pour seule loi celle du rapport de force. Au nom de quoi prétendre alors défendre le faible et l’orphelin ?
- C’est accepter pour soi et pour les autres, aujourd’hui et à l’avenir, qu’il n’y aura plus jamais ni agresseur ni agressé, puisqu’il n’y aura plus rien pour les différencier : ni justice, ni droit, ni système de valeurs.
C’est « sans autre forme de procès », que Le Loup emporte L’Agneau et puis le mange. Les velléités haineuses et expansionnistes s’arrêtent rarement dans le temps et aux frontières, à moins qu’on ne les arrête. Mettre Le Loup et L’Agneau dans un même enclos ne les oblige en aucune façon à vivre ensemble.
La paix avec l’Azerbaïdjan, et son mentor la Turquie, ne sera possible qu’à la condition que ces États reconnaissent leur crime, le qualifient, le réparent, assainissent leurs structures étatiques et sociales de toute volonté d’anéantissement des Arméniens, garantissent à l’Arménie et à la République d’Artsakh les conditions politiques et économiques nécessaires à leur viabilité. Soit un processus au long court, qui commence par la reconnaissance du crime, la punition des agresseurs et la réparation du préjudice. Un processus long et difficile, mais la seule condition pour espérer un jour un vivre ensemble en paix.
PS n°1 à l’attention des médias qui se complaisent à réserver le même traitement aux Arméniens et à la coalition Azerbaïdjan-Turquie :
Les chiffres parlant mieux que toute autre chose, quelques données relatives aux parties que vous mentionnez. La guerre du Haut-Karabakh a opposé :
- L’Azerbaïdjan et la Turquie : 91 millions d’habitants ; un budget militaire de 25 milliards $.
- La République d’Artsakh soutenue par l’Arménie : 3,15 millions d’habitants ; un budget militaire de 495 millions $.
Aux côtés des combattants azéris, la Turquie a engagé 4000 djihadistes syriens.
Pactiser avec l’Azerbaïdjan et la Turquie, c’est s’asseoir sur l’Habeas corpus, la liberté d’expression et la liberté d’opinion :
- Classement mondial de la liberté de la presse 2020 (Reporters Sans Frontières) : l’Azerbaïdjan 168e, la Turquie 154e, l’Arménie 61e.
- 110 000 sites internet ont été fermés en Turquie en 2016.
- Dès le début de la guerre en septembre 2020, le président Aliyev a ordonné la clôture des réseaux sociaux en Azerbaïdjan.
PS n°2 à l’attention de ceux qui ont la naïveté ou un intérêt quelconque à croire ou à faire croire que le développement de relations économiques suffit à garantir la paix :
Si tel était le cas, l’option serait sérieuse et à envisager pour sauver des vies, des deux côtés.
Mais abdiquer le droit, la justice et la morale pour sauver des vies à un instant T ne garantit pas qu’elles soient sauvées à l’instant T+1. Le droit, la justice et la morale, ne le garantissent pas non plus malheureusement, mais alors il revient à chacun de choisir en conscience dans quel monde il souhaite vivre et celui qu’il souhaite léguer aux générations à venir : celui du rapport de force qui régit tous les êtres vivants ou celui du droit qui régit les sociétés humaines.
Céder des territoires en échange du développement de relations commerciales, peut permettre d’épargner des vies à un instant T. Mais de la même façon, cela ne garantit pas qu’elles soient sauvées plus tard, au contraire. Les territoires cédés représentent autant de ressources disparues. Sans compter qu’ils sont autant de positions stratégiques qui hier protégeaient naturellement les Arméniens (chaînes de montagne), et qui demain seront autant de postes de tir avantageux pour l’Azerbaïdjan et la Turquie. Les coups de feu azéris ponctuent d’ailleurs déjà le quotidien des villages frontaliers du Syunik.
Autrement dit, un État en position de faiblesse, qui cède ses ressources et ses positions stratégiques dans une perspective de profit à court terme, ne peut garantir ni en théorie ni en pratique un avenir sûr et prospère à son peuple. Il n’est même pas besoin de se demander s’il le souhaite réellement.
Méliné
Sources : 1. https://www.un.org/fr/observances/living-in-peace-day /
2. https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/


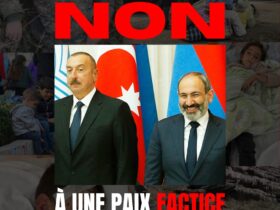



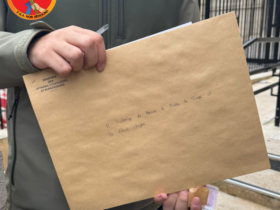


Follow Us